| |

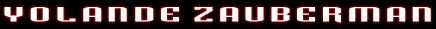
Ce qui intéressait Yolande Zauberman dans "la
guerre à Paris" était de montrer l'humanité du personnage
de Jules. Son humanité, c'est de ne pas être dans l'obéissance
comme premier réflexe de l'homme qui ne sait pas. Il n'est pas
dans l'imitation. Il n'est pas non plus dans l'expérience ce qui
fait qu'il est étranger partout. Quand il tue le soldat allemand
et le policier français c'est qu'il commet le geste d'un garçon
qui a accepté de ne plus exister comme un être humain à ses propres
yeux. Il se retrouve en position de décider de la vie ou de la
mort de ses parents et d'autres gens qu'il ne connaît pas. Le
seul pouvoir qui lui est donné, c'est d'être un instrument de
la machine policière. C'est quand il réalise à quel point il a
été manipulé qu'il tire. Dans la solitude où il se trouve, quelque
chose du spectacle de la force de l'occupant le sidère. Yolande
Zauberman a parlé de ce sentiment avec un résistant qui disait
qu'il avait regardé le spectacle de la guerre à Paris avec une
sorte de légèreté de spectateur, alors qu'il était juif et qu'il
aurait pu être arrêté à tout moment. Avoir cette forme de légèreté,
c'est oser être humain jusqu'au bout.
Depuis quelques années, beaucoup de gens sont venus raconter à
Yolande l'antisémitisme qui existait dans leur famille, dans leur
milieu, alors qu'elle n'avait pas cherché à recueillir ce genre
de renseignements. " A mon grand étonnement, j'ai pu les entendre,
sans être blessée, sans les juger. C'était une façon de dire que
l'antisémitisme avait existé là où on vivait, mais de le dire
sans culpabilité, comme une histoire dont on a envie de se séparer
en la nommant. Pour moi, il est évident que si Jules avait pu
parler de ce qui lui arrivait, tout aurait été différent. D'ailleurs,
quand il parle, tout change. Mais trop tard. " Le film ne traite
pas de la déportation et ne parle pas de l'horreur qui s'est passée.
Il ne traite donc pas vraiment de l'Allemand Nazi. Le vis-à-vis,
c'est la police française mais avec un personnage qui apparemment
n'est pas le plus terrible des policiers, même pas antisémite.
" Quand j'étais petite, si on me demandait ce qui me ferait le
plus plaisir, je disais que j'aurais aimé être une minute dans
le corps des autres, pour sentir ce qu'ils ressentent, comprendre
comment ils voient les choses. En tournant 'Caste criminelle en
Inde', j'ai compris que j'étais pour les gens que je filmais un
mystère aussi grand qu'ils l'étaient pour moi. Ce film, c'est
un peu l'invitation que je fais : venez voir un peu comment on
se sent dans la peau d'un presque étranger, d'un traître presque
résistant, un graçon qui est entre plusieurs places ".
Yolande et Gérard Brach ont écrit le scénario de manière radicale,
en faisant en sorte que la trahison devienne le centre du film.
 Yolande
Zauberman : " La position de Jules dans le film est proche de
ma position de cinéaste. Je n'aime que le présent, il y a quelque
chose dans le passé à quoi je suis allergique. Je fais des films
d'époque avec une sorte de rapport phobique à la nostalgie, des
films sur le passé où je veux rejoindre le présent de l'époque.
Gérard Brach avait d'ailleurs lui aussi ce genre de phobie ; il
s'était même juré de ne jamais écrire sur ce sujet. " Yolande
voulait tourner dans des endroits qui existaient à l'époque et
qui représentaient alors une certaine modernité. Comme le film
se passe dans un milieu assez populaire, l'équipe a choisi les
cités ouvrières des années 30 dans lesquelles on sent un réel
souci de bien-être. " On s'est retrouvé dans cet environnement
très proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Dans les décors mais
aussi dans les costumes. " Il y a eu un minimum de reconstitution.
Les acteurs sont habillés comme à l'époque et presque comme aujourd'hui
aussi. " Tous les repères vestimentaires sont presque invisibles
et c'est ça qui m'intéressait pour parler de ces personnages qui
sont des presque étrangers. Qui ont l'air d'avoir tous les signes
de reconnaissance des autres personnes, mais qui ont une légère
différence, presque invisible. " Le détail vestimentaire n'apparaît
pas comme un repère historique dans ce film. Yolande
Zauberman : " La position de Jules dans le film est proche de
ma position de cinéaste. Je n'aime que le présent, il y a quelque
chose dans le passé à quoi je suis allergique. Je fais des films
d'époque avec une sorte de rapport phobique à la nostalgie, des
films sur le passé où je veux rejoindre le présent de l'époque.
Gérard Brach avait d'ailleurs lui aussi ce genre de phobie ; il
s'était même juré de ne jamais écrire sur ce sujet. " Yolande
voulait tourner dans des endroits qui existaient à l'époque et
qui représentaient alors une certaine modernité. Comme le film
se passe dans un milieu assez populaire, l'équipe a choisi les
cités ouvrières des années 30 dans lesquelles on sent un réel
souci de bien-être. " On s'est retrouvé dans cet environnement
très proche de ce qu'on voit aujourd'hui. Dans les décors mais
aussi dans les costumes. " Il y a eu un minimum de reconstitution.
Les acteurs sont habillés comme à l'époque et presque comme aujourd'hui
aussi. " Tous les repères vestimentaires sont presque invisibles
et c'est ça qui m'intéressait pour parler de ces personnages qui
sont des presque étrangers. Qui ont l'air d'avoir tous les signes
de reconnaissance des autres personnes, mais qui ont une légère
différence, presque invisible. " Le détail vestimentaire n'apparaît
pas comme un repère historique dans ce film.
Depuis plusieurs années, Yolande Zauberman tourne des documentaires
"lyriques" où fusionnent harmonieusement réalité et sentiment.
Le thème commun de ses films réside dans le passage d'une frontière
entre deux mondes. Ses récits, situés pour les 3 premiers films
dans des pays lointains, concernent les êtres que la société rejette.
Avec 'Clubbed to Death', elle rend à nouveau hommage aux "damnés"
de la terre. Mais cette fois, à proximité de chez nous, dans la
banlieue parisienne.
Filmographie de Yolande ZAUBERMAN 1988 : "Classified people"
(doc sur les déchirures raciales en Afrique du Sud) 1989: "Caste
criminelle" (doc sur les castes en Inde) 1993 : "Moi Ivan,
toi Abraham" (long métrage sur l'amitié entre 2 petits garçons,
l'un juif, l'autre pas, dans la Pologne des années 30) 1996
: " Clubbed to death (Lola) " (long métrage). Yolande Zauberman
est aussi l'auteur de l'idée originale du film de Etienne Chatiliez,
" Tanguy ". Yolande avait déjà dirigé Elodie Bouchez dans " Clubbed
to death ".
Mai 2002
|